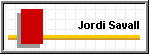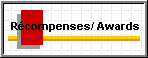Texte paru dans: / Appeared in:
*

Diapason # 591 (05/2011)
Pour
s'abonner / Subscription information
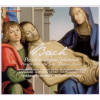
Mirare MIR136
Tout récemment, Sigiswald Kuijken prenait le choeur de solistes comme point de départ d’une lecture radicalement intime de la Passion selon saint Matthieu (cf. n° 589). Benoît Haller, au contraire, profitait de l’effectif réduit pour exacerber le théâtre sacré de la Saint Jean (cf. n° 580). S’ils n’ont pas su convaincre, au moins posaient-ils deux regards neufs. Philippe Pierlot ne prend pas le risque. Huit solistes (quatre concertistes et autant de ripiénistes, selon le matériel original) ne sont pas pour lui le moyen de libérer le mot de l’inertie d’une formation plus large, de donner au geste vocal une énergie plus directe: il en fait les outils d’un esthétisme où chaque détail peut être supérieurement maîtrisé et intégré.
Ce qui a pu séduire dans les cantates se révèle univoque à l’échelle et face à l’enjeu de la Passion. Cette Saint Jean, travail d’orfèvre poli par l’impeccable Ricercar Consort, dresse une moyenne de tout ce qui s’est fait. Un exemple, au début du premier choeur. Pierlot gomme pudiquement les dissonances des hautbois mais prépare l’entrée des voix avec un crescendo de cordes mille fois entendu. Contemplation ou action, il faudrait choisir. Il rate les deux. Ses chanteurs, tout affairés à poser pile ensemble les « r » roulés des premiers « Herr », ne sont ni implorants, ni hiératiques, ni fulgurants. Tout à la fois, tout à moitié, donc pas grand-chose.
On sait depuis l’enregistrement pionnier d’Andrew Parrott (Virgin, 1991) que le choeur de solistes peut métamorphoser les interventions de la foule dans la Saint Jean, leur donner plus de venin ou d’ironie cruelle. Pierlot ne saisit pas l’occasion. Ses turbae filent droit et sonnent curieusement compactes dans cette prise de son qui voudrait tout mettre au premier plan. Gageons que l’interprétation aurait eu le même aspect avec un choeur de chambre, et que les chorals sonneraient mieux — l’articulation si scrupuleusement détaillée tourne à l’artifice avec un effectif si réactif. Le terrible « Christus der uns selig macht», au début de la seconde partie, fait pâle figure à côté de celui de Parrott. Qui pourtant n’est pas Harnoncourt.
Toute l’équipe se fond dans la droiture de son chef. On ne badine pas avec le rythme, même quand le chant se fait déploration — « Zerfliesse » obstinément raide, « Es ist vollbracht» sans abîmes. Reprochera-t-on dans ce contexte à Hans-Jörg Mammel un Evangéliste appliqué, d’une belle autorité mais sans rayonnement?
Une dernière réserve, pour
la version bricolée par Pierlot à partir des quatre états de la Saint
Jean parvenus jusqu’à nous. Il retient dans la première partie I” « Himmel
reisse» pour soprano et basse de 1725, mais deux numéros plus loin,
préfère au trépidant « Zerschmettert mich » ajouté la même année le
bref « Ach, mein Sinn »de 1724. Bach n’a-t-il pas voulu ce contraste
? Conserver le premier choeur de 1724 (« Herr, unser Herrscher ») et
jouer à la fin le « Christe du Lamm Gottes » de 1725 pose un autre
problème : Bach conçoit le nouveau finale comme un pilier symétrique du
nouveau premier choeur, également composé sous la forme d’un vaste choral
figuré (« O Mensch, bewein dein Sùnde Gross »). L’un ne va pas sans
l’autre. On ira plutôt chercher la Saint Jean de 1725 intégralement gravée
par Neumann (MDG)et celle de 1749 par Suzuki (Bis). La version habituelle
étant peu ou prou celle de 1724.
Gaëtan Naulleau
Cliquez l'un ou l'autre
bouton pour découvrir bien d'autres critiques de CD
Click either button for many other reviews